Plan de l'article :
L’héroïne « Antigone » se confronte au grand événement : le travail sur l’événementialité
La « Sorcière » compatissante au regard myope : des petites histoires au service de la grande histoire
Duras joue à la Pythie : la poéticité et la fictionnalité de l’histoire
Honoré de Balzac est l’un des pionniers de la vision proprement historique du présent. En 1842, lorsqu’il écrit dans l’avant-propos de La Comédie humaine la célèbre formule « la société française allait être l’historien, je ne devais être que le secrétaire1
», il pense sans doute à son rôle d’écrivain. Mais ses efforts pour compter dans la presse de son temps montrent qu’il a aussi conscience que les journalistes, y compris lui-même, contribuent à l’histoire du XIXe siècle que la société française est en train d’écrire.
À la fin du XIXe siècle, tout lecteur d’un journal partage le sentiment, aussi illusoire soit-il, d’être témoin et parfois même acteur de l’histoire en construction grâce au nouveau lien que le système médiatique établit entre les individus et le monde. Mais cette irruption présumée de l’histoire dans l’espace journalistique induit cependant une confusion systématique entre l’actualité et l’historicité, tout événement ayant vocation à être considéré comme historique, chaque instant qui passe étant un moment d’histoire en construction. Alain Vaillant emprunte une notion à la rhétorique traditionnelle des figures et nomme « hypotypose journalistique » cet effet de grossissement, qui procure au lecteur la double sensation qu’il a été pour ainsi dire présent à l’événement et que cet événement était historiquement capital2
. Avec l’affaire Dreyfus et le fameux « J’Accuse… ! » de Zola publié par L’Aurore, la puissance de la presse atteint son paroxysme et entre dans une étape nouvelle de son histoire, bien qu’une grande crise d’identité du journalisme français couve depuis la naissance d’une nouvelle presse, que certains ont pu dénoncer comme « américanisée ». La presse, tout au long de la première moitié du XXe siècle, se heurte à des obstacles. Concurrencée par de nouveaux médias, la radio et les actualités filmées, elle est dominée par le pouvoir politique et les puissances d’argent : se trouvant « au milieu du gué3
», la presse française doit trouver des compromis face à ces difficultés. Mais dans le même temps, elle ne renonce jamais à la tradition du journalisme littéraire qui la distingue de ses concurrents européens.
Marie-Ève Thérenty a mené l’enquête sur l’histoire des femmes journalistes des années 1830 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale4
, en éclairant leurs pratiques du métier, leurs postures et leurs poétiques innovantes. Selon elle, pour mieux se présenter ou se représenter dans un champ dans lequel les femmes manquent a priori de légitimité, certaines femmes journalistes tendent à neutraliser ou masculiniser les postures qui sont souvent très genrées, alors que d’autres cherchent à valoriser l’existence et la possibilité d’aptitudes spécifiques des femmes à la profession. Marguerite Duras est certainement l’héritière de ces dernières5
. Mais à la différence de ses consœurs qui sont pour la plupart tombées dans l’oubli aujourd’hui, elle se fait remarquer dans la deuxième moitié du XXe siècle par ses engagements intellectuels qui témoignent de sa participation à l’histoire et ses poétiques journalistiques qui lui permettent de raconter l’autre scène de l’histoire.
Cet article examine ainsi de quelle manière Marguerite Duras rend compte de l’actualité du grand événement dans l’espace journalistique et dans quelle mesure sa poétique journalistique évolue au cours de la période 1957-1980. En nous appuyant sur des sources de presse, des journaux et revues auxquels Marguerite Duras a contribué, à savoir France-Observateur, Le Nouvel Observateur, Sorcières, Cahiers du Cinéma et Libération, nous analyserons les rapports qu’entretiennent les textes journalistiques de Marguerite Duras avec l’histoire, ainsi que les postures qu’elle a successivement endossées pour intervenir dans la presse. De prime abord, nous nous demanderons dans quelle mesure le journalisme durassien se nourrit de l’événement, et comment Duras retravaille l’événementialité. C’est que nous appelons la posture d’Antigone. Ensuite, nous proposerons d’analyser de quelle façon Marguerite Duras réécrit, sinon réinvente des petites histoires, des facettes anodines de la vie ainsi que des nouvelles attrapées dans la rue, pour les faire entrer dans sa poétique journalistique. Ce sera la posture de la Sorcière. Enfin nous montrerons que le dernier temps de sa réinterprétation médiatique de l’histoire passe par un travail sur la poétisation et la fictionnalisation de l’événement d’actualité : Duras s’incarne alors fantasmatiquement en Pythie.
L’héroïne « Antigone » se confronte au grand événement : le travail sur l’événementialité
Dans ces fractures de l’Histoire, Duras ne peut qu’être à son aise, comme si son être entier ne trouvait de réelle signification que dans ces temps de passion, de tension, où l’homme se révèle à lui-même, dans le danger et le risque, contraint aux choix, acculé à prendre parti. Elle aime ces situations extrêmes où son engagement est entier, où la tragédie revient sur le théâtre du monde, où elle redevient, comme par spasmes, la petite héroïne Antigone, comparable encore à cette figure de Jeanne d’Arc pour laquelle elle éprouve une grande fascination, « sublime », dit-elle, dans Les Parleuses6
.
Depuis ses débuts journalistiques en 1957 jusqu’aux années 1980, les grands événements comme la guerre d’Algérie, les mouvements sociaux comme Mai 1968 et le Mouvement de libération des femmes (MLF), ainsi que les conflits internationaux semblent être la pâture de l’écriture journalistique de Marguerite Duras. Un grand nombre d’articles parus dans la presse témoigne de son grand enthousiasme et elle trouve de l’intérêt intellectuel à traiter à sa façon les événements qui ont occupé les Unes, constitué les scoops et les chocs de l’époque.
Après quelques piges données ici ou là, Marguerite Duras débute vraiment comme journaliste en 1957, l’époque où l’actualité en France est dominée par le conflit algérien7
. C’est le 28 février 1957, en pleine bataille d’Alger, que Marguerite Duras publie son premier article intitulé « Fleurs de l’Algérien » à la quatorzième page de France-Observateur, l’organe hebdomadaire de gauche qui, avec L’Express, prend la tête du combat pour la décolonisation dans les années 19508
. À mesure que la guerre devient de plus en plus violente, elle fait paraître une série d’articles qui racontent le retentissement de la guerre d’Algérie : la xénophobie et le chauvinisme en France métropolitaine après les attentats du F.L.N. (« Tourisme à Paris », France-Observateur, 25 juillet 19579
), les échos des combats dans l’est-Constantinois à Paris (« Alors, on ne guillotine plus ? », France-Observateur, 19 décembre 1957), la naissance de la revue de contestation politique Le 14 Juillet (« Pourquoi Le 14 Juillet ? », France-Observateur, 24 juillet 1958), la capitale déserte après le putsch d’Alger et la remémoration en filigrane du bombardement d’Hiroshima (« Paris, six d’août », France-Observateur, 7 août 1958). Maniant une écriture efficace, Marguerite Duras saisit sur le vif les détails et les indices des vies ordinaires et les remet dans un contexte d’actualité plus large. Sous sa plume se dessinent la lutte et les frissons de chaque individu dont le destin est indissociablement lié aux événements de l’époque et profondément influencé par les troubles du monde.
Peu après, avec le retour du général de Gaulle au pouvoir, Duras revit le cauchemar de la Seconde Guerre mondiale : les crimes nazis, l’élimination des Juifs, l’attente désespérée de son mari Robert Antelme déporté en Allemagne… Cette fois, les événements du passé et ceux du présent se croisent, redoublant le chagrin. C’est pourquoi le 9 novembre 1961, moins d’un mois après le massacre du 17 octobre 196110
, Marguerite Duras publie « Les Deux ghettos » et met en parallèle l’entretien avec deux Algériens et la confidence d’une survivante du ghetto de Varsovie. La convocation de l’histoire, par la comparaison entre les Algériens et les Juifs, sert à éclairer le moment présent, comme en témoigne ce propos indifférent et cruel de M., la survivante du ghetto : « J’ai appris hier qu’il y avait beaucoup d’Algériens noyés dans la Seine. Il n’y a là-dedans rien d’étonnant pour moi11
».


En effet, Marguerite Duras fait partie des rares journalistes qui osent prendre la parole pendant la guerre d’Algérie, étant donné que cette guerre divise la société française : la prise de position inappropriée risque de défier voire de trahir le pouvoir établi ainsi que les principes d’État. Mais Marguerite Duras éprouve quand même ostensiblement de la compassion pour les « ennemis » du pays. C’est pourquoi Alain Vircondelet la qualifie de « petite Antigone12
», convoquant ainsi l’héroïne grecque qui, au nom de l’amour fraternel, se hasarde à enfreindre les lois de la cité pour ramasser les cadavres de ses frères qui s’étaient associés aux traîtres : « Je ne suis pas faite pour vivre avec ta haine, mais pour être avec ce que j’aime 13
».
Outre le génocide des Juifs et la guerre d’Algérie, des événements comme Mai 68 nourrissent aussi le journalisme durassien. Dans « 20 Mai 1968 : texte politique sur la naissance du Comité d’Action Étudiant-Écrivain » (Cahiers du cinéma, juin 1980) et « L’Homme nu de la Bastille » (L’Autre journal, avril 1985), Mai 68 est présenté comme une utopie politique à laquelle la fondatrice du Comité d’Action Étudiant-Écrivain a cru comme aux premiers temps de Cuba. Elle se fait un devoir de le rappeler bien après 196814
:
Rien ne nous lie que le refus. Dévoyés de la société de classe, mais en vie, inclassables mais incassables, nous refusons. Nous poussons le refus jusqu’à refuser de nous intégrer dans les formations politiques qui se réclament ce que nous refusons. Nous refusons le refus programmé des institutions oppositionnelles. Nous refusons que notre refus, ficelé, empaqueté, porte une marque. Et que tarisse sa source vive, et que se rebrousse son cours. […] Nous sommes la préhistoire de l’avenir. Nous sommes cet effort. Ce préalable à partir de quoi celui-ci sera possible. Nous sommes au début du PASSAGE. Nous sommes cet effort 15
.
Cet article atteste que la distance temporelle lui permet vraiment de mêler actualité et historicisation de l’événement.
Mais cette poétique de la mise en contexte des événements dans l’écriture du journal connaît un changement radical en 1980. L’événement ne représente plus le grand contexte dans lequel les gens se battent et se débattent, mais a tendance à faire écho à la lutte personnelle voire à se confondre avec l’histoire personnelle. Par exemple, dans un numéro spécial des Cahiers du cinéma (n° 312-313, juin 1980), Duras aborde maintes fois la question de la guerre d’Afghanistan pour proclamer son indignation contre l’Union Soviétique et s’attaquer violemment à la politique du PCF dont elle était exclue depuis 1950. De plus, l’affaire Goldman lui permet de faire l’aller-retour entre le monde intérieur et le monde extérieur. Au beau milieu d’un article critique sur le film La Nuit du chasseur surgit soudain un paragraphe en italique sur l’assassinat de Pierre Goldman, intellectuel d’extrême gauche passé par le grand banditisme et assassiné dans des conditions mystérieuses en 1979 : « Les meurtriers de Pierre Goldman : atteints de la même maladie de la mort. […] Pour un million d’anciens francs, ont tué Pierre Goldman » (« La nuit du chasseur », Cahiers du cinéma, juin 1980). Plus loin, elle établit de nouveau un rapprochement entre l’actualité immédiate et personnelle, la mort de Pierre Goldman et au-delà l’holocauste : « À l’époque où j’ai eu fini le premier Aurélia Melbourne, Goldman a été tué » (« Aurélia Aurélia quatre », Cahiers du cinéma, juin 1980). Sans parler de la grève de Gdansk dont elle s’empare dans ses chroniques parues dans Libération à l’été 80, l’événement s’étendant au-delà de l’actualité politique et allant jusqu’à cristalliser le désir amoureux : « Sur Gdansk j’ai posé ma bouche et je vous ai embrassé 16
» sous-entend certainement la mise en scène de la première rencontre avec Yann Andréa.
Écrire en Antigone pour Duras, c’est tout d’abord se jeter comme une militante féroce, angoissée voire sacrificielle dans la tempête de l’histoire, tout en revendiquant le droit de dire non au régime actuel ; dans les années 1980, lorsque l’événement commence à entrer en résonance avec sa vie personnelle, elle retrouve une posture d’Antigone mais une Antigone qui « écoute et entend la parole intérieure 17
», que Vincent Estellon appelle la « Reine des cœurs18
». La Reine des cœurs, c’est une Antigone qui est passée par la posture de la Sorcière.
La « Sorcière » compatissante au regard myope : des petites histoires au service de la grande histoire
M. D. – Il serait quand même bon de rappeler ce que disait Michelet, là, sur les sorcières.
X. G. – Ah, oui, dis.
M. D. – Ah, c’est admirable, c’est dans le livre La Sorcière. D’ailleurs, je voulais te dire tout à l’heure que c’est lui..., tu te souviens de son livre sur les femmes quand il parlait des menstrues, mais pour lui c’était un..., une source d’érotisme. Oui, il disait que dans le haut Moyen Âge les femmes étaient seules dans leurs fermes, dans la forêt, pendant que le seigneur était à la guerre – chaque fois que je peux, je cite cette histoire, je la trouve sublime – et qu’elles s’ennuyaient profondément, dans leurs fermes, seules, et qu’elles avaient faim, lui était aux croisades ou à la guerre du Seigneur, et que c’est comme ça qu’elles ont commencé à parler, seules, aux renards et aux écureuils, aux oiseaux, aux arbres, et que, quand le mari revenait, elles continuaient, ça je l’ajoute, sans ça on se serait aperçu de rien, mais c’est les hommes qui les ont trouvées parlant seules dans la forêt.
X. G. – Et moi, j’ajouterais : les hommes ont dû dire : « Elles sont bien folles, c’est bien des folies de femmes. »
M. D. – Voilà, et on les a brûlées. Pour arrêter, endiguer la folie, endiguer la parole féminine 19
.
Marguerite Duras lit et relit avec passion l’essai de Michelet La Sorcière, son livre préféré, et l’utilise comme vaste métaphore de la condition des femmes. Chez Michelet, les femmes du Moyen Âge parlent aux oiseaux, aux arbres et aux animaux dans la forêt quand leurs maris sont partis aux croisades. Elles osent casser l’ordre déjà établi par les hommes et ne veulent plus rester dans le silence. La solidarité de Marguerite Duras avec ces « sorcières » provient en effet du sentiment de marginalité et d’oppression qu’elle partage toute sa vie avec les Juifs, le peuple algérien, les laissés-pour-compte, les participants de Mai 68, les ouvriers de Gdansk. Plus généralement, Duras s’insurge contre l’injustice, dont les femmes plus que les hommes sont victimes. Écrire en sorcière, c’est écrire sur les marges, en montrant les invisibles et en privilégiant la petite histoire.
Mais la sorcière qu’incarne Marguerite Duras dans les années 1950 n’est pas virulente. Au contraire, c’est une femme journaliste compatissante qui, « curieuse de tout, avec ses gestes de myope rajuste toujours ses lunettes, pour tenter de mieux voir encore et de ne rien laisser échapper 20
». Durant la guerre d’Algérie, elle observe de très près la vie quotidienne de toutes les catégories sociales qui vivent dans un pays secoué sévèrement par les troubles nationaux et les batailles sanglantes hors du métropolitain. Son premier article « Fleurs de l’Algérien » publié dans France-Observateur, signé « M.D. », est précédé d’« Un fait divers raconté par Marguerite Duras », dans lequel elle raconte une scène banale mais allégorique : deux hommes en civil chassent un jeune Algérien vendant à la sauvette des fleurs et renversent d’un coup de poing sa charrette : « le carrefour s’inonde des premières fleurs du printemps (algérien 21
) ». À la suite de l’incident, alors qu’une dame hurle qu’ils ont bien fait d’agir ainsi contre cette « racaille », le reste des passants lui achète en un instant ses fleurs tombées par terre avant qu’il soit emmené au poste de police. L’arrestation du jeune Algérien à Paris fait penser sans doute aux prisonniers à Alger ainsi qu’à la torture dont ils sont victimes. À travers une scène banale, Marguerite Duras réussit à toucher ce qui est caché et enterré sous l’apparence grandiose de l’histoire.
Ce regard myope de Duras journaliste est non seulement raffiné mais aussi éminemment moraliste. Elle aime rencontrer et interviewer les gens dans la rue et montre un grand intérêt pour les choses qui ont l’air les plus futiles. Nombre d’articles écrits à cette époque témoignent de cette curiosité. Dans « Paris canaille » (France-Observateur, 28 février 1957), à travers un entretien avec une veuve de 71 ans, qui « va au tribunal comme d’autres en visite » et « avoue sans honte comme sans cynisme » sa faute, Marguerite Duras expose la vie misérable des gens déshérités et fait résonance à l’insurrection du F.L.N. : « Je n’ai pas encore envie de mourir, alors je dois voler. » Encore dans « Racisme à Paris » (France-Observateur, 6 mars 1958), Marguerite Duras raconte l’histoire de Marcelle B., victime d’une persécution policière parce qu’elle se promène à une heure et demie du matin avec son camarade de travail algérien. Les agents de police, après avoir persécuté Marcelle B., embarquent son ami et le gardent jusqu’à quatre heures du matin, pour l’unique raison qu’il est kabyle. Cette petite scène permet à Duras de débusquer la misère des Algériens, de faire surgir la détresse et exploser la révolte, alors qu’elle éprouve comme toujours de la compassion et du souci pour ces gens qui la ramènent à sa condition d’enfance.
Comme toujours chez Duras, la grande histoire se joint à la petite histoire, et ses textes donnent à voir au-delà du récit factuel une moralité journalistique. Définitivement humaniste, elle se comporte en journaliste moraliste qui suit plutôt sa propre morale : elle ne veut pas qu’on lui impose quoi que ce soit, elle veut transgresser les contraintes et les préjugés établis, parler de tout – les attentats du F.L.N, le jeune Algérien qui vend des fleurs, les Paris Canailles, les touristes de Paris, le bombardement d’Hiroshima –, c’est pourquoi elle signe entre-temps le Manifeste des 121. Ayant une forte envie de dénoncer l’injustice sociale, elle s’occupe des marginaux, des exilés, des traqués et des expulsés de leur propre terre, se dresse contre le racisme, la xénophobie, le chauvinisme et surtout les « camps » où l’on torture et tue les hommes et prend l’écriture pour attaquer ces « ténèbres » ; elle raconte ce qu’elle voit, elle pose les questions morales sans détour, comme en témoignent des questions très simples et dénudées de maniérisme qu’elle a posées dans « Les Deux ghettos » pour extraire les réponses les plus franches sur la peur, la solitude, les haines, les difficultés quotidiennes voire la vengeance22
…
Mais dans les années 1970, lorsque les mouvements de libération des femmes prennent de l’ampleur, Marguerite Duras, en posture de Sorcière, devient plus radicale et violente : elle fait partie d’un groupe de précurseuses qui, conscientes du fait que les femmes ont été pendant plusieurs siècles victimes des valeurs patriarcales et n’ont jamais été traitées d’une façon juste, revendiquent le droit des femmes à disposer librement de leur corps et luttent résolument contre les différentes formes d’oppressions et de misogynie23
. C’est pourquoi Marguerite Duras signe en 1971 le « Manifeste des 343 », pétition parue dans le numéro 334 du magazine Le Nouvel Observateur qui réclame « le libre accès aux moyens anticonceptionnels et l’avortement libre » et lance un défi à la morale courante de l’époque.
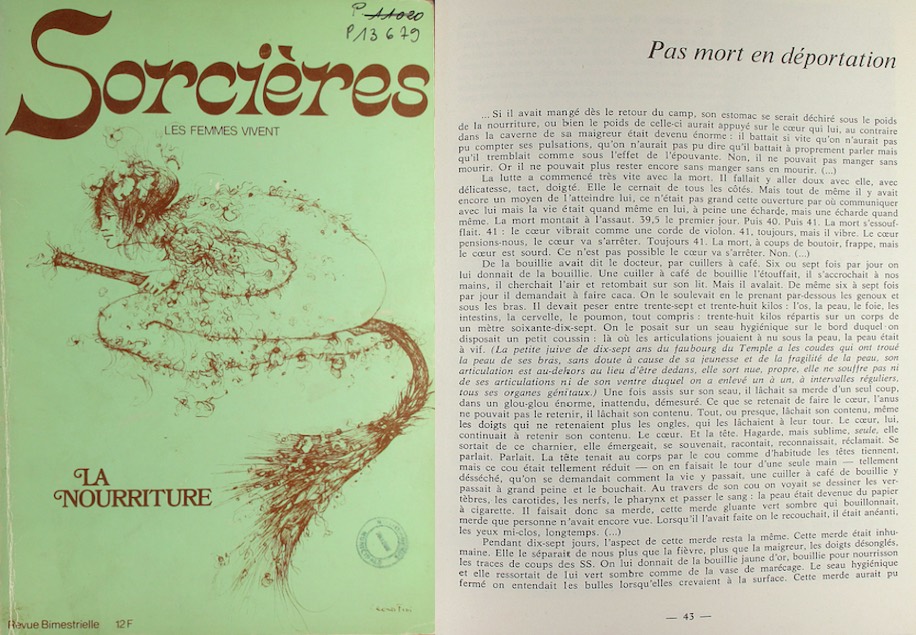
(à droite) « Pas mort en déportation », Sorcières, n° 1, 1er janvier 1976
Même si elle ne se revendique jamais comme une activiste féministe24
, Marguerite Duras « s’engage dans l’histoire de toutes les femmes en lutte25
» et collabore volontairement aux nombreuses publications de femmes, à savoir Sorcières, revue féministe créée le 1er janvier 1976 par Xavière Gauthier. Elle garde encore son regard myope mais se tourne peu à peu vers les histoires personnelles tout en rappelant des événements historiques passés. Divisé en deux fragments, l’article « Pas mort en déportation26
» est publié anonymement dans les deux premiers numéros de la revue Sorcières. En racontant le retour miraculeux de son mari Robert Antelme du camp de Dachau, elle cherche à exposer « ce qu’un homme peut devenir, ce qu’on peut lui faire subir et la permanence de l’amour qu’on peut lui porter27
». À une époque où les crimes nazis sont largement méconnus par la nouvelle génération, Marguerite Duras continue à révéler les secrets obscurs des êtres humains qui peut-être commencent à tomber dans l’oubli.
Grâce à ce geste moraliste, Marguerite Duras parvient à l’intériorité du monde, à retenir des petits secrets qui se cachent derrière la grandeur de l’Histoire et fait briller une humanité qui s’élargit à l’universel.
Duras joue à la Pythie : la poéticité et la fictionnalité de l’Histoire
Michel Drucker – Les hommes ont toujours eu besoin de réponses, même si un jour elles s’avèrent fausses, ou seulement provisoires. Alors en l’an 2000, où seront les réponses ?
Marguerite Duras – Eh bien il n’y aura plus que ça ! La demande sera telle que… il n’y aura plus que des réponses. […] Je crois que l’homme sera littéralement noyé dans l’information. Dans une information constante. Sur son corps. Sur son devenir corporel. Sur sa santé. Sur sa vie familiale. Sur son salaire. Sur son loisir. Ce n’est pas loin du cauchemar. […] Tout sera bouché. Tout sera investi. Il restera la mer, quand même. Les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme, un jour, lira. Et puis tout recommencera 28
.Marguerite Duras semble se dresser, irréductible sur son trépied, face à la crevasse fumante qui figure seulement son démon, comme notre Pythie29
.
Après quelques années consacrées au cinéma, Marguerite Duras reprend l’écriture en 1980. Suite à la commande de Serge July, directeur du journal Libération, elle collabore de nouveau avec la presse mais livre aux lecteurs son actualité comme « un écrivain envahi par la réalité et qui fait face avec ses mots30
». Sous le titre « Les Yeux verts », elle publie chaque mercredi, du 16 juillet au 17 septembre 1980, dans Libération, une chronique traitant d’« événements qui l’auraient intéressée et qui n’auraient pas forcément été retenus par l’information d’usage31
».
Le rôle de la sorcière s’efface en même temps que le regard myope s’estompe : l’été 1980 témoigne de l’émergence d’une nouvelle posture et la formation d’une nouvelle poétique journalistique. Les yeux de la Pythie se font voyants voire visionnaires. Elle scrute le ciel et les nuages de sa chambre, ou du haut des fenêtres du palace des Roches noires ; elle regarde la mer, pendant quelques heures ou toute une journée, la mer où les yeux gris de l’enfant apparaissent et disparaissent.
Durant cet été pluvieux, Marguerite Duras fait éclater par une « écriture courante32
», fragmentée et parcellaire, des événements comme l’invasion de l’URSS en Afghanistan et les Jeux olympiques de Moscou en contrepoint, les obsèques du shah d’Iran où le président américain est absent, la grande famine en Ouganda qui la renvoie au Vietnam et aux camps nazis, l’attentat de la gare de Bologne et le cyclone Allen qui « dégage la force de la bombe d’Hiroshima toutes les quatre secondes33
». Alors qu’en même temps, les changements météorologiques, la plage, la marée, les mouettes, les touristes, l’histoire entre l’enfant aux yeux gris et la jeune monitrice, l’histoire de David racontée par la monitrice et la fable de la source se mêlent à ces événements :
Il était une fois, a dit la jeune monitrice, un petit garçon qui s’appelait David, il était blond, il était sage, il était parti faire le tour du monde sur un grand bateau qu’on appelait l’Amiral Système, et voilà que la mer devient mauvaise, très mauvaise. En Iran, le gouvernement de la mort a pris définitivement le pouvoir. Le parti le plus fort se reconnaît à sa potentialité de mort, sa faculté plus ou moins grande de l’administrer. Ils ont tué des voleurs à la tire, ils tuent des trafiquants de drogue. Et ils tuent des homosexuels 34
.
Il est clair qu’à partir de L’Été 80, la mise en perspective de l’événement historique se fait par le biais de l’écriture personnelle, par l’ellipse, par le récit, voire par le concerto de la fiction…

(à droite) « Gdansk : la démocratie réinventée », Libération, 22 août 1980
Cependant, l’événement qui secoue le plus Marguerite Duras dans cette période est incontestablement « la grève calme des ouvriers du chantier naval de Gdansk35
» dont elle s’empare à partir de la sixième chronique. Avec ce mot magique, Gdansk, toute l’actualité politique en été 80 s’efface et se fond en une seule unité : « elle est telle un phare qui éclairerait la grande décharge nauséabonde du socialisme européen. Que les autres se taisent. Gdansk, c’est nous. Et c’est le réel36
. » Gdansk, catalyseur du désir, fait sortir même l’intime de Marguerite Duras : « Je vous donne encore cette nuit-ci, sans nom, sans forme. De même que je vous donne Gdansk. […] Comme Aurélia, je ne peux pas garder Gdansk pour moi seule, comme j’écris Aurélia j’écris les mots de Gdansk, et comme Aurélia je dois vous adresser Gdansk au sortir de moi. La voici entre nous, entre nos corps contenue37
. » Prenant la posture de pythie dont la parole a un pouvoir oraculaire, Marguerite Duras déclare à la fin de l’été 1980 : « Je ne sais plus rien non plus des différences entre Gdansk et Dieu38
. »
En fait, les dix chroniques publiées dans Libération portent à son plus haut niveau la conception d’une nouvelle forme journalistique que Duras a déployée et réinventée au cours de sa carrière de journaliste. Prise dans les ambiguïtés de l’écriture du moi, l’écriture journalistique de Marguerite Duras a dérivé vers la littérature, jusqu’à transgresser la dichotomie entre la réalité et l’imaginaire, abolir les frontières qui distinguent le dehors et le dedans et éprouver les limites entre écriture journalistique et écriture littéraire en fondant les deux au creuset de « la chambre noire39
», étant donné que c’est dans cette chambre de l’écriture qu’ont été effectués « des glissements, des analogies et des mosaïques40
» entre l’anecdotique et l’événementiel, entre l’amour pour « vous » et celui pour Gdansk, entre le gris des yeux de l’enfant et le gris de la mer, où la vie personnelle est mise en scène et le réel a été vécu comme un mythe : « Oui, l’enfant aux yeux gris était là, et la jeune fille aussi, ils regardaient la mer. Et je les ai ramenés à moi eux aussi, comme je le fais de vous, de la mer et du vent et je vous ai enfermés dans cette chambre égarée au-dessus du temps41
. »
Conclusion
Depuis le XIXe siècle, la presse entretient un lien à la fois étroit et complexe avec l’événement, en considérant qu’elle ne se lasse jamais de produire des discours soit descriptifs soit analytiques pour tâcher de dire, voire de fabriquer les événements du jour. C’est ainsi qu’au XXe siècle, lorsqu’on étudie l’émergence de la notion d’événement en sciences humaines, les deux supports discursifs auxquels cette dernière est rattachée indéfectiblement sont d’un côté la fabrique médiatique, et de l’autre, bien naturellement, la fabrique historique42
. Pour la période 1935-1991, la période de production de Marguerite Duras, l’universitaire Yves Lavoinne, spécialiste de la presse, a repéré trois postures possibles pour les journalistes face à l’histoire : le serviteur de l’historien futur, l’historien du présent et le médiateur43
. L’hypothèse de cet article est que le type de relation que Marguerite Duras entretient avec l’histoire durant sa carrière journalistique se confond probablement avec le deuxième « archétype ». À ce titre, il n’est pas surprenant que l’écriture journalistique de Marguerite Duras se nourrisse d’une série de grands événements bien médiatisés qu’elle a vécus elle-même : la guerre d’Algérie, Mai 1968, le Mouvement de libération des femmes, la guerre d’Afghanistan, des grèves de Gdansk et plus généralement la guerre froide.
Quoi qu’il en soit, le journalisme durassien n’a pas pour objectif de rassembler et de compiler un amas d’informations et de faits bruts sur l’injustice sociale et la résistance des Français durant la guerre, la montée des régimes totalitaires et la militarisation de la planète. Ce qui intéresse le plus Marguerite Duras journaliste, c’est d’exposer, voire d’analyser l’impact qu’a sur chaque individu tout ce qui est en haut, comme elle l’a fait dans Hiroshima mon amour : « Vous voyez, j’ai mis face au chiffre énorme des morts d’Hiroshima l’histoire de la mort d’un seul amour inventé par moi44
». C’est pourquoi maintes fois c’est à travers une situation banale, une affaire anodine, une conversation attrapée dans un café ou encore des nouvelles capturées ici ou là qu’elle reproduit une autre scène de l’histoire : les fleurs d’Algérien, les Paris Canailles, Mademoiselle Marcelle B., une conversation boulevardière au café du Palais-Royal, les confidences des deux ghettos, le retour de Robert en déportation, l’assassinat de Pierre Goldman… Comme toujours chez Duras, la grande histoire se mêle à la petite histoire, et ses textes donnent à voir au-delà de l’apparence du simple fait vécu et de l’effet de scoop qu’il suscite.
En passant en revue l’ensemble des articles journalistiques de Duras, de ses premiers essais dans France-Observateur jusqu’à ses articles étonnants parus dans Libération à l’été 1980, il est frappant de constater l’évolution du journalisme durassien. Alors qu’elle se contentait au départ d’être un spectateur compatissant qui observe de très près les vies d’ordinaires, raconte tout ce qui se passe autour d’elle en profitant du contexte des grands événements et juge parfois au nom d’une moralité qui dépasse tout et s’élargit à l’humanité, petit à petit, elle change de ton et emprunte au journalisme une forme de « négligence de l’écrit » qui renvoie à la vertu d’improvisation des chroniqueurs d’antan, comme par exemple celle de Jules Vallès, pionnier dans l’écriture sensible de l’actualité au XIXe siècle : « Ils exposeraient leurs plus intimes et plus émouvants souvenirs. Mais, de grâce, pas de litanies et point de malédictions. Ni scapulaires ni cocardes ! Le récit simple, l’impression franche, le détail vrai, inexorable45
». Duras en vient à réinventer une nouvelle poétique journalistique en suivant la voie des générations de femmes journalistes depuis Delphine de Girardin. À partir des années 1980, elle n’est plus une pure observatrice et se jette dans le grand courant de l’époque où l’histoire personnelle et l’histoire collective convergent. Sûre qu’elle porte en elle la vérité universelle, elle réclame « une appréhension hypersubjective de l’actualité46
», comme si tout à coup son écriture s’approchait des grands écrits prophétiques et rejoignait une fonction sacrale. Jouant à la Pythie, elle se cache derrière une ruse de voyance qui l’affranchit de sa peur du jugement et la pousse jusqu’à façonner en plus de sa propre histoire, l’Histoire de tous.
Bibliographie
I. Corpus primaire
« Les Fleurs de l’Algérien », France-Observateur, n° 355, 28 février 1957, p. 14.
« Paris Canaille », France-Observateur, n° 357, 14 mars 1957, p. 14.
« Tourisme à Paris », France-Observateur, n° 376, 25 juillet 1957, p. 11.
« Alors, on ne guillotine plus ? », France-Observateur, n° 397, 19 décembre 1957, p. 14.
« Racisme à Paris », France-Observateur, n° 408, 6 mars 1958, p. 15.
« Pourquoi Le 14 Juillet ? », France-Observateur, n° 429, 24 juillet 1958, p. 15.
« Paris, six d’août », France-Observateur, n° 431, 7 août 1958, p. 15.
« Les Deux Ghettos », France-Observateur, n° 601, 9 novembre 1961, p. 8-10.
« Pas mort en déportation », Sorcières, n° 1, janvier 1976, p. 43-44.
« Le spectateur », « Je me souviens », « L’Homme fait avec de la peur », « « 5 janvier 1980 Actualité », « 20 mai 1968 : texte politique sur la naissance du Comité d’Action Étudiants-Écrivains », « La nuit du chasseur », « Aurélia Aurélia quatre », Cahiers du cinéma, n° 312-313, juin 1980.
« L’Été 1 », Libération, 16 juillet 1980, p. 4, rubrique « Société ».
« L’Été 2 », Libération, 23 juillet 1980, p. 4, rubrique « Société ».
« L’Été 3 », Libération, 30 juillet 1980, p. 4, rubrique « Société ».
« L’Été 4 », Libération, 6 août 1980, p. 4, rubrique « Société ».
« L’Été 5 », Libération, 13 août 1980, p. 2.
« L’Été 6 », Libération, 20 août 1980, p. 2.
« L’Été 7 », Libération, 27 août 1980, p. 2.
« L’Été 8 », Libération, 3 septembre 1980, p. 4, rubrique « Société ».
« L’Été 9 », Libération, 10 septembre 1980, p. 2.
« L’Été 10 », Libération, 17 septembre 1980, p. 4-5, rubrique « Société ».
« L’Homme nu de la Bastille », L’Autre journal, n° 4, avril 1985, p. 65.
II. Corpus secondaire
Butel, Michel, L’Autre Journal (1984-1992). Une anthologie, Les Arènes, 2012, p. 10-11.
Capone, Carine, Frontières de l’évènement, frontières de la littérature : l’appropriation de l’évènement dans la littérature des années soixante à nos jours (Marguerite Duras, Claude Simon, Emmanuel Carrère, Laurent Mauvignier), thèse de doctorat, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, soutenue le 3 décembre 2015.
De Certeau, Michel, « Marguerite Duras : On dit », dans Danielle Bajomée et Ralph Heyndels (dir.), Écrire, dit-elle, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1985, p. 264-265.
Duras, Marguerite, Hiroshima mon amour, Paris, Gallimard, 1960.
–, Les Parleuses, Paris, Minuit, 1974.
–, L’Été 80, Paris, Minuit, 1981.
–, La Douleur, Paris, P.O.L., « Folio », 1985.
–, Le Bureau de poste de la rue Dupin et autres entretiens, Paris, Gallimard, 2006.
–, œuvres complètes. Tomes 1 et 2, sous la direction de Gilles Philippe, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2011.
–, La Passion suspendue : entretiens avec Leopoldina Pallotta della Torre, Paris, Seuil, 2013, p. 40.
–, œuvres complètes. Tomes 3 et 4, sous la direction de Gilles Philippe, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2014.
–, Le dernier des métiers, Paris, Seuil, 2016.
Emeric, Philippe, « "Suicides" à Alger », France-Observateur, n° 357, 14 mars 1957, p. 6.
Estellon, Vincent, « Mémoire, genre, identité et lien social : le cri d’Antigone », L’Esprit du temps, n° 58, février 2010, p. 141-159.
Ferenczi, Thomas, L’invention du journalisme en France, Paris, Plon, 1993.
Gobille, Boris, « Les mobilisations de l'avant-garde littéraire française en mai 1968. Capital politique, capital littéraire et conjoncture de crise », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 158, 2005, p. 30-61.
–, Mai 68, Paris, La Découverte, 2008.
Lasserre, Audrey, Histoire d’une littérature en mouvement : textes, écrivaines et collectifs éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (1970-1981), thèse de doctorat, Université de la Sorbonne nouvelle Paris III, soutenue le 14 novembre 2017.
Lavoinne, Yves, « Le journaliste, l'histoire et l'historien. Les avatars d'une identité professionnelle (1935-1991) », Réseaux, volume 10, n° 51, 1992, p. 39-53.
Martin, Laurent, La Presse écrite en France au XXe siècle, Paris, Librairie Générale Française, 2005, p.143-147.
Riot-Sarcey, Michèle, Histoire du féminisme, Repères, La Découverte, 2002.
Sophocle, Antigone, traduction de Jean et Mayotte Bollack, Paris, Minuit, 1999.
Stora, Benjamin, Histoire de la guerre d’Algérie : 1954-1962, La Découverte, Paris, 2004.
Thérenty, Marie-Ève, La Littérature au quotidien, Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2007.
–, « Duras, definitely Duras. Tradition and Innovation in the literary journalism of Marguerite D. », article dans Richard Keeble et John Tulloch, Global Literary Journalism: Exploring the Journalistic Imagination, vol. 2, Peter Lang, New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien, 2014, p. 155-170.
–, Femmes de presse, femmes de lettres : de Delphine de Girardin à Florence Aubenas, Paris, CNRS Éditions, 2019.
Vaillant, Alain, « L’Histoire au quotidien », dans Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Pairs, Éditions du Nouveau Monde, 2011, p. 1319-1329.
Vallès, Jules, Œuvres I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975.
Vircondelet, Alain, Marguerite Duras : la traversée d’un siècle, Paris, Plon, 2013.
- 1 Honoré de Balzac, « Avant-propos » (1842), dans La Comédie humaine, t. I, éd. Pierre-Georges Castex (dir.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 11.
- 2 Alain Vaillant, « L’Histoire au quotidien », dans Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, Paris, Éditions du Nouveau Monde, 2012, p. 1322.
- 3 Thomas Ferenczi, L’invention du journalisme en France, Paris, Plon, 1993, p. 237.
- 4 Marie-Ève Thérenty, Femmes de presse, femmes de lettres : de Delphine de Girardin à Florence Aubenas, Paris, CNRS Éditions, 2019, p. 19.
- 5 Ibid., p. 363 : « Je terminerai par trois cas représentatifs dans l’après Seconde Guerre mondiale : Françoise Giroud, la cofondatrice en 1953 de l’Express qu’elle a codirigé jusqu’en 1974 ; Marguerite Duras, l’auteur du plus gros scandale qu’une journaliste française ait jamais causé avec l’article « Sublime, forcément sublime Christine V. » en 1985, et Florence Aubenas qui, avec son reportage immergé Le Quai de Ouistreham en 2000, a prouvé que les pratiques des femmes journalistes d’avant-guerre peuvent trouver une nouvelle actualité dans le paysage contemporain. Ces trois expériences fortement différentes par leur contexte, leur style et leur positionnement dans le champ médiatique et littéraire, témoignent toutes d’une mémoire de la différence et de la manière de la réduire ou de la surmonter par la ‘’littérature”. »
- 6 Alain Vircondelet, Marguerite Duras : la traversée d’un siècle, Paris, Plon, 2013, p. 201.
- 7 Le 7 janvier 1957, le gouvernement français confie au général Jacques Massu les pleins pouvoirs de police sur le Grand Alger dans le but de mettre fin aux activités « terroristes » animées par le FLN. Ce dernier réplique par une recrudescence d’attentats à la bombe et une grève générale qui débute le 28 janvier. En réaction, l’armée exerce une sévère répression, arrête un grand nombre de suspects et recourt à la torture pour obtenir des informations et démanteler les organisations secrètes dans l’agglomération. Par conséquent, de nombreux dirigeants du FLN sont capturés au mois de février, y compris Larbi Ben M’hidi qui est assassiné après avoir été torturé.
- 8 Laurent Martin, La Presse écrite en France au XXe siècle, Paris, Librairie Générale Française, 2005, p.143-147.
- 9 Le 28 mai 1957, la rivalité sanglante entre le F.L.N. et le M.N.A. culmine avec le massacre de la population civile du douar Melouza, causant 301 morts et 14 blessés. Le 11 juin, Maurice Audin est arrêté, puis disparaît et meurt à une date inconnue. C’est au mois de juillet durant l’acmé de la bataille d’Alger que Duras donne au France-Observateur son article sous un titre anodin « Tourisme de Paris ».
- 10 Le massacre du 17 octobre 1961 est la répression meurtrière par la police française des manifestations pacifiques des milliers d’Algériens à Paris. Il y a eu des dizaines de morts dont les corps ont été jetés dans la Seine, des centaines de blessés et plus de 1000 arrestations.
- 11 Marguerite Duras, « Les Deux Ghettos », France-Observateur, n° 601, 9 novembre 1961, p. 8-10.
- 12 Alain Vircondelet, Marguerite Duras : la traversée d’un siècle, op. cit., p. 201.
- 13 Sophocle, Antigone, traduction de Jean et Mayotte Bollack, Paris, Éditions de Minuit, 1999, p. 38 : « Créon : Mais le bon et le méchant ne sont pas égaux en matière de droits. Antigone : Ces principes sont-ils sacrés sous terre, qui sait ? Créon : Jamais l’ennemi n’est ami, même s’il est mort. Antigone : Je ne suis pas faite pour vivre avec ta haine, mais pour être avec ce que j’aime. » Cette phrase est également citée par Vincent Estellon, « Mémoire, genre, identité et lien social : le cri d’Antigone », L’Esprit du temps, n° 58, février 2010, p. 146 : « Figure politique de l’espoir en l’humain, Antigone dénonce l’usurpation de la loi, et n’accepte pas que soit défaite la dimension de l’humain. Plutôt que d’accepter de vivre en se faisant passer pour folle (non responsable de ses actes), Antigone les revendique et les clame tout haut pour solliciter l’esprit critique. »
- 14 Voir Marguerite Duras, La Passion suspendue : entretiens avec Leopoldina Pallotta della Torre, Paris, Éditions du Seuil, 2013, p. 40 : « Ne pas savoir où l’on allait, comme cela nous arrivait dans la rue, pendant ces journées-là, savoir seulement qu’on allait, qu’on se bougeait, en quelque sorte, sans crainte des conséquences, des contradictions… »
- 15 Marguerite Duras, « 20 Mai 1968 : texte politique sur la naissance du Comité d’Action Étudiant-Écrivain », Cahiers du cinéma, n° 312-313, juin 1980, p. 39-42.
- 16 Marguerite Duras, « L’Été 10 », Libération, 17 septembre 1980, p. 4-5, rubrique « Société ».
- 17 Vincent Estellon, « Mémoire, genre, identité et lien social : le cri d’Antigone », op. cit., p. 146.
- 18 Ibid.
- 19 Marguerite Duras et Xavière Gauthier, Les Parleuses, Paris, Minuit, 1974, p. 206-207.
- 20 Alain Vircondelet, « L’actualité imaginaire », dans Aliette Armel (dir.), Marguerite Duras, Paris, Le Magazine littéraire, 2013, « Nouveaux regards », p. 145.
- 21 Marguerite Duras, « Les Fleurs de l’Algérien », France-Observateur, n° 355, 28 février 1957, p. 14.
- 22 Ses questions sont simples, directes et tout courtes : « Le problème des chambres ? Manger ? Votre solitude ? L’ennui ? Le travail ? La vengeance ? »
- 23 Voir Audrey Lasserre, Histoire d’une littérature en mouvement : textes, écrivaines et collectifs éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (1970-1981), thèse de doctorat, Université de la Sorbonne nouvelle Paris III, soutenue le 14 novembre 2017.
- 24 Voir Marguerite Duras, La Passion suspendue : entretiens avec Leopoldina Pallotta della Torre, op. cit., p 149 : « — Que pensez-vous du féminisme ? — Je me méfie de toutes ces formes un peu obtuses de militantisme qui ne conduisent pas toujours à une vraie émancipation féminine. Il y a des contre-idéologies plus codifiées que l’idéologie elle-même. »
- 25 Audrey Lasserre, Histoire d’une littérature en mouvement : textes, écrivaines et collectifs éditoriaux du Mouvement de libération des femmes en France (1970-1981), op. cit., p. 18.
- 26 Il s’agit d’une sorte de journal intemporel que Marguerite Duras tenait pendant la fin de la guerre. Cet article autobiographique connaît toute son ampleur dans son roman La Douleur publié en 1985.
- 27 Marguerite Duras, Outside suivi de Le monde extérieur, Paris, P.O.L, « Folio », 1984 et 1993, p. 349.
- 28 Marguerite Duras interrogée par Michel Drucker, Les 7 Chocs de l’an 2000, Antenne 2, 1985, cité dans Sophie Bogaert (dir.), Marguerite Duras, Le dernier des métiers, Paris, Seuil, 2016, p. 353.
- 29 Michel de Certeau, « Marguerite Duras : On dit », dans Danielle Bajomée et Ralph Heyndels (dir.), Écrire, dit-elle, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1985, p. 264-265.
- 30 Marguerite Duras, « L’Été 1 », Libération, 16 juillet 1980, p. 4, rubrique « Société ».
- 31 Marguerite Duras, L’Été 80, Paris, Minuit, 1981, p. 9.
- 32 Sophie Bogaert (dir.), Marguerite Duras, Le dernier des métiers, op. cit., p. 302 : « Je disais, vous savez, que l’écriture courante, que je cherchais depuis si longtemps, je l’ai atteinte, là. Et que par écriture courante, je dirais écriture presque distraite, qui court, qui est plus pressée d’attraper des choses que de les dire, voyez-vous. »
- 33 Marguerite Duras, « L’Été 5 », Libération, 13 août 1980, p. 2.
- 34 Marguerite Duras, « L’Été 3 », Libération, 30 juillet 1980, p. 4, rubrique « Société ».
- 35 Marguerite Duras, « L’Été 6 », Libération, 20 août 1980, p. 2.
- 36 Marguerite Duras, « L’Été 7 », Libération, 27 août 1980, p. 2.
- 37 Ibid.
- 38 Marguerite Duras, « L’Été 10 », Libération, 17 septembre 1980, p. 4-5, rubrique « Société ».
- 39 Voir Anne Cousseau, « La chambre noire de l’écriture », dans Bernard Alazet, Christiane Blot-Labarrère et André Z. Labbarère (dir.), Duras, Paris, Cahiers de l’Herne, 2005, p. 114 : « Ainsi la mer face à l’Hôtel des Roches Noires, à Trouville, est-elle un lieu inépuisable de l’écrit, qui renvoie invariablement à ces “images princeps” de l’enfance selon la formule bachelardienne, donnant ainsi l’impulsion de l’écriture par l’effet de la rêverie poétique “qui imagine en se souvenant” : elle est “ comme une sorte d’image mentale constante” qui féconde l’œuvre de façon plus ou moins souterraine, elle est la “mer écrite”. Dans l’Été 80, elle fonctionne ainsi comme un lieu proprement “poïetique”, dans lequel puisent, intimement mêlés, la mémoire d’enfance et l’imaginaire de l’écrivain, et qui déporte ainsi l’écriture de la chronique journalistique vers la littérature. Dans le dernier chapitre, l’équivalence est clairement posée entre la “mer noire”, plongée dans l’obscurité de la nuit, et la “la chambre noire” de l’écriture. »
- 40 Marguerite Duras, Œuvres complètes, t. 3 et 4, éd. Gilles Philippe (dir.), Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2014, p. 1730-1731.
- 41 Marguerite Duras, « L’Été 8 », Libération, 3 septembre 1980, p. 4, rubrique « Société ».
- 42 Voir Carine Capone, Frontières de l’évènement, frontières de la littérature. L’appropriation de l’évènement dans la littérature des années soixante à nos jours (Marguerite Duras, Claude Simon, Emmanuel Carrère, Laurent Mauvignier, thèse de doctorat, Paris, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, soutenue le 3 décembre 2015.
- 43 Yves Lavoinne, « Le journaliste, l'histoire et l'historien. Les avatars d'une identité professionnelle (1935-1991) », Réseaux, vol. 10, n° 51, 1992, p. 39-53.
- 44 Marguerite Duras, « Je me souviens », Cahiers du cinéma, n° 312-313, juin 1980.
- 45 Jules Vallès, lettre du 13 novembre 1864 au Figaro, repris dans Œuvres, t. I, éd. Roger Bellet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 1272.
- 46 Marie-Ève Thérenty, « Duras, definitely Duras. Tradition and Innovation in the Literary Journalism of Marguerite D. », dans Richard Keeble et John Tulloch, Global Literary Journalism : Exploring the Journalistic Imagination, vol. 2, Peter Lang, New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien, 2014, p. 155-170.
